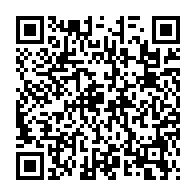Au Sahel, le développement économique freiné par l’insécurité

Région stratégique d’Afrique de l’Ouest, le Sahel, est confronté à des défis sécuritaires croissants qui entravent son développement économique. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont particulièrement touchés par cette insécurité galopante, qui paralyse les activités quotidiennes ainsi que le progrès économique de ces pays.

-
La situation sécuritaire au Sahel s’est considérablement dégradée ces dernières années. Selon le Global Terrorism Index 2025, la région reste l’épicentre du terrorisme mondial, avec plus de la moitié des décès dus à cette forme de violence en 2024. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger figurent à eux trois dans le top 5 des pays les plus touchés par le terrorisme, avec 3 066 morts et 522 blessés en 2024. Cette explosion de la violence montre à quel point l’insécurité est devenue un fléau pour la région.
L’envenimement de la situation sécuritaire au Sahel est tel, que le nombre de mort s’est décuplé depuis 2019. Ce phénomène souligne l’impuissance, des forces maliennes soutenues par les russes d’Africa Corps. Pourtant, ces derniers avaient mené des opérations ciblées contre le JNIM près de la frontière algérienne. Ces missions ne se sont pas révélées concluantes puisque les djihadistes sont parvenus à imposer leur emprise sur ces territoires, comprenant notamment des ressources minières.
Les causes profondes de cette insécurité sont multiples, mais peuvent s’expliquer par les choix politiques des régimes sahéliens. Les gouvernements burkinabè, malien et nigérien ont souvent privilégié des approches sécuritaires militaires, au détriment de stratégies de développement économique et social plus inclusifs. Cette priorité, accordée à la défense, a relégué au second plan des secteurs cruciaux comme l’éducation, la santé et les infrastructures, exacerbant ainsi les crises humanitaires et ralentissant le développement socio-économique. Par exemple, au Burkina Faso, la loi de finances pour 2025 alloue environ 28% du budget de l’État aux secteurs de la défense et de la sécurité, soit environ 960 milliards de FCFA. Cette allocation massive contraste avec les ressources limitées dédiées aux secteurs sociaux, surtout que les problèmes sécuritaires du Burkina Faso, sont loin d’être résolus.
L’insécurité tue aussi l’économie sahélienne
L’insécurité croissante au Sahel a des conséquences désastreuses sur le développement économique des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et de la région plus largement. Les conflits armés, la pauvreté, l’exclusion et la criminalité organisée contribuent à la détérioration des conditions de vie et freinent toutes initiatives de développement.
Toujours au Burkina Faso, l’insécurité a entraîné une chute de 15% de ses exportations en 2022 à la suite de tensions diplomatiques. De même, au Mali, les investissements étrangers directs ont diminué de 20%, entraînant une contraction de son PIB de 3%.
D’une autre manière, l’insécurité gangrène, toute la production agricole, freinant ainsi l’agriculture qui reste l’un des principaux moteurs de la croissance dans tout le Sahel. Namata Sanda, un agriculteur nigérien, cultivant le coton, le sorgho, le maïs et le millet déplorait : « [...] Mon revenu mensuel a considérablement baissé, passant de 2 000 à 330 dollars. Cela n’a pas été facile pour moi et ma famille ». De plus, les infrastructures essentielles comme les écoles et les centres de santé sont souvent la cible d’attaques, privant ainsi les communautés des services essentiels.
Parmi ces difficultés, l’intervention de la Russie, via ses groupes paramilitaires Wagner et Africa Corps, complique davantage la situation. Ces groupes, officiellement déployés pour des opérations de contre-terrorisme, se sont rapidement transformés en acteurs économiques, exploitant les richesses naturelles des pays sahéliens, sans réelle transparence. Au Mali, le groupe Wagner a été accusé d’abus généralisés des droits humains pour faciliter son exploitation des mines locales. Cette situation détourne l’attention des véritables besoins de la population, et empêche les investissements étrangers légitimes qui pourraient stimuler l’économie locale. Les ressources naturelles, telles que l’or, le lithium et l’uranium, sont exploitées sans bénéficier réellement aux populations locales .
Pour ne plus être complice de cette prédation, les gouvernements sahéliens doivent impérativement revoir leurs stratégies pour offrir des solutions durables à cette crise. Cette incapacité à préserver l’ordre et à stabiliser la situation de leur territoire, a permis à des groupes étrangers comme Wagner et Africa Corps de s’infiltrer dans l’exploitation des ressources naturelles. Toutefois, des exemples encourageants comme celui de la Côte d’Ivoire, montrent qu’un mélange d’améliorations sécuritaires et d’investissements économiques peut repousser l’extrémisme grâce des solutions pérennes.
@info241.com

-